 Sujet : musique médiévale, biographie, troubadours, portrait, vidas, naissance de l’art des troubadours
Sujet : musique médiévale, biographie, troubadours, portrait, vidas, naissance de l’art des troubadours
Auteur médiéval : Guilhem de Poitiers ou Guillaume IX d’Aquitaine (1071-1126)
Période : Moyen Âge central, XIIe siècle
Ouvrage : La Tròba, l’invention lyrique occitane des troubadours XIIe-XIIIe s. Gérard Zuchetto, éd Tròba Vox, 2020 (2e édition)
Bonjour à tous,
 oilà longtemps que nous nous étions promis de tirer le portrait de Guilhem de Poitiers ou Guillaume IX d’Aquitaine, seigneur et poète que l’histoire nous désigne encore comme le tout premier troubadour du Moyen Âge. « A tout seigneur, tout honneur », notre plaisir est, aujourd’hui, doublé puisque c’est avec Gérard Zuchetto que nous allons le faire. Ce talentueux musicologue, chanteur et musicien chercheur, spécialiste de ces questions nous fait, en effet, la grande faveur de nous autoriser à partager, ici, un extrait de son ouvrage La Tròba, l’invention lyrique occitane des troubadours des XIIe-XIIIe siècles : celui qui concerne, justement, la présentation du comte Guilhem de Peiteus, ainsi que des éléments de sa biographie .
oilà longtemps que nous nous étions promis de tirer le portrait de Guilhem de Poitiers ou Guillaume IX d’Aquitaine, seigneur et poète que l’histoire nous désigne encore comme le tout premier troubadour du Moyen Âge. « A tout seigneur, tout honneur », notre plaisir est, aujourd’hui, doublé puisque c’est avec Gérard Zuchetto que nous allons le faire. Ce talentueux musicologue, chanteur et musicien chercheur, spécialiste de ces questions nous fait, en effet, la grande faveur de nous autoriser à partager, ici, un extrait de son ouvrage La Tròba, l’invention lyrique occitane des troubadours des XIIe-XIIIe siècles : celui qui concerne, justement, la présentation du comte Guilhem de Peiteus, ainsi que des éléments de sa biographie .
Quelques notes sur le débat des origines

Un poète de langue d’oc peut en cacher un autre ?
Avant notre comte Guillaume, n’y-a-t-il eu « quelques épaules de géants pour lui permettre de voir plus loin » ? Sans même s’éloigner du pays d’Oc et concernant la reconnaissance d’une paternité entière de l’art des troubadours à notre cher coens de Poetieus, on pourrait, avec Maria Dimistrescu, se poser la question de la possible influence, sur la poésie de notre noble seigneur, de certains de ses contemporains, et notamment de Eble II de Ventadour.
Selon la médiéviste, l’homme, lui-même vicomte de Ventadorn et vassal de Guilhem, aurait pu être, pour ce dernier et pour d’autres, une sorte de mentor en poésie. C’est en tout cas la thèse qu’elle défendit à la fin des années 60. Elle alla même au delà de la simple idée d’inspiration en formant l’hypothèse que certaines chansons attribuées à notre troubadour du jour auraient bien pu avoir été reprises par lui, mais écrites de première main, par cet autre poète et seigneur languedocien (voir Èble II de Ventadorn et Guillaume IX d’Aquitaine – Cahiers de civilisation médiévale n°43 (1968), Maria Dimistrescu). Il faut dire que le double registre de notre troubadour « bifronte », capable de manier, avec virtuosité, grivoiserie et courtoisie, pouvait avoir de quoi dérouter. Quoiqu’il en soit, l’hypothèse soulevée par la médiéviste ne put jamais véritablement être tranchée. En l’absence de sources écrites d’époque permettant de l’établir, elle a donc rejoint le rang des spéculations invérifiables (infalsifiables dirait Popper) et à ce jour, Guillaume IX d’Aquitaine n’a pas été officiellement détrôné de son statut légitime de premier des troubadours.
Mais alors quoi ? Pour le reste, cet art des troubadours, est-ce une forme culturelle totalement ex-nihilo ? Est-ce encore une variation, une adaptation, un « contrepied », un art qui naît à la faveur de la féodalité et de ses nouvelles normes politiques et relationnelles, ou encore une réponse, qui pourrait prendre, par endroits, des allures de contre feu à la réforme grégorienne (voir Amour courtois : le point avec 3 experts ou encore réflexions sur la naissance de l’amour courtois) ? Tout cela est possible mais, au delà de toute hypothèse et avec 800 à 900 ans de recul, il résulte que l’art des troubadours fait encore figure de nouveauté culturelle aux formes originales : nouvel exercice littéraire, nouvelle façon de versifier, nouveaux codes qui vont promouvoir, au moins dans le verbe, de nouveaux modèles relationnels, de nouvelles formes du sentiment amoureux, etc…
La Tròba de Gerard Zuchetto
ou l’invention lyrique occitane des troubadours
Laissons là le grand débat des origines sur l’art des troubadours. Il est nécessairement complexe comme le sont tous les objets culturels et leur circulation. Il est temps de s’engager sur les pas du comte, pour lever un coin du voile sur sa personnalité, son art et quelques uns de ses vers, accompagné de notre érudit du jour, Gerard Zuchetto, en le remerciant encore chaleureusement de cette contribution.
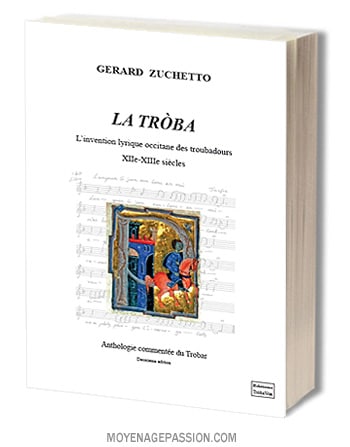
Au format broché, vous y découvrirez plus de 800 pages sur le sujet des troubadours. En dehors de votre librairie habituelle, vous pourrez le trouver en ligne au lien suivant : La troba : L’invention lyrique occitane des troubadours XIIe-XIIIe siècles. Inutile d’ajouter que nous vous le recommandons vivement.
Sur ce, nous vous laissons en bonne compagnie, en vous souhaitant une excellente lecture.
Une biographie de Guilhem de Peiteus – Guilhem de Poitiers par G Zuchetto.
Farai un vers de dreg nien
Je ferai un vers sur le droit néant
Qu’eu port d’aicel mestier la flor
Car moi je porte de ce métier la fleur
L’inventeur !
L’un des premiers troubadours connus fut un des plus grands seigneurs de l’Europe médiévale : lo coms de Peiteus, Guilhem, septième comte de Poitou et neuvième duc d’Aquitaine, né en 1071.
Lorsqu’il hérite de son père, en 1086, le Poitou, la Gascogne, l’Angoumois et le Limousin, des territoires immenses entre Nord et Sud, de l’Anjou aux Pyrénées, et d’Est en Ouest du Massif central à l’Atlantique, ses domaines sont bien plus importants que ceux du roi de France, Philippe Ier, qui ne contrôle réellement à la même époque qu’un petit fief autour de Paris, Etampes et Orléans, la “little France”, pour les Anglais, une île.
Bon chevalier d’armes, jovial et vantard, le fier vicomte du Limousin est poète. Il chante pour réjouir ses companhos, compagnons de batailles et de distractions.
Companho farai un vers [pauc] convinen
et aura·i mais de foudatz no·i a de sen
et er totz mesclatz d’amor e de joi e de joven.
Compagnons, je ferai un vers peu convenable
et il y aura plus de folie que de bon sens
et il sera tout mêlé d’amour, de joie et de jeunesse !
Pour chanter amor, joi e joven, le seigneur de Poitiers l’exprime en romans, terme qui désigne la langue occitane en opposition au latin :
Merce quier a mon companho
s’anc li fi tort qu’il m’o perdo
et eu prec en Jesus del tron
et en romans et en lati.
Je demande merci à mon compagnon
si jamais je lui fis tort qu’il me pardonne
et je prie Jésus sur son trône
en romans et en latin.
A l’exemple des joglars, ces jongleurs-musiciens aux multiples talents qui allaient par les chemins vendre leurs services, mais avec la finesse du lettré, ce grand trichador de domnas se joue des mots et les versifie adroitement pour plaire aux dames et les tromper : Si·m vol midons… Ma dame veut me donner son amour, je suis prêt à le prendre, à l’en remercier, à le cacher, et à la flatter et à dire et faire ce qu’il lui plaît, et à honorer son mérite et à élever ses louanges…Guilhem annonce ainsi l’aube du trobar :
Mout jauzens me prenc en amar
un joi don plus mi volh aizir…
Très joyeux je me prends à aimer
une joie dont je veux jouir davantage…

Le comte est “Ennemi de toute pudeur et de toute sainteté”, écrit Geoffroy Le Gros, un chroniqueur de l’époque. Ce libertin joyeux et fanfaron, n’est pourtant pas un rustre, il recommande à ses auditeurs et surtout au fin aman, l’amant pur :
Obediensa deu portar
a manhtas gens qui vol amar
e conve li que sapcha far
faitz avinens
e que gart en cort de parlar
vilanamens.
Il doit montrer obédience / obéissance
à maintes gens celui qui veut aimer
et il lui convient de savoir accomplir
des faits avenants
et de se garder, à la cour, de parler
comme un vilain.
Guilhem invente les mots-clefs et les règles du trobar, et il se vante d’être le premier, l’inventeur. Et, sûr de sa valeur de trobador e d’amador, il tient à exposer son métier : “J’ai nom Maître infaillible et jamais ma maîtresse ne m’aura une nuit sans vouloir m’avoir le lendemain car je suis si bien instruit en ce métier, et je m’en vante, que je puis gagner mon pain sur tous les marchés.” Il se donne lui-même le titre de maistre certa, maître infaillible, en amour comme en poésie.
Guilhem de Peiteus, l’homme politique et chef d’Etat, ne fut ni un grand batailleur, ni un conquérant zélé. Au retour d’un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, sentant sa fin proche, le poète écrivit son adieu au monde, Pois de chantar…, en tant que troubadour, comte de Poitiers et chrétien. Guilhem mourut à Poitiers le 10 février 1126 après quarante ans de règne, et l’on suppose qu’il fut enterré en l’abbaye de Saint-Jean-l’Évangéliste à Montierneuf.
La biographie tardive résume sa vie en quelques lignes laconiques :
Lo coms de Peiteus si fo uns dels maiors cortes del mon e dels maiors trichadors de domnas, e bon cavalier d’armas e larcs de domneiar ; e saup ben trobar e cantar.
Le comte de Poitiers fut l’un des plus grands courtois du monde et le plus grand trompeur de dames, et bon chevalier d’armes et généreux en amour; et il sut bien trouver et chanter.
Sur les onze vers connus de Guilhem de Peiteus, seuls deux poèmes nous ont été transmis avec les mélodies en notation carrée : Companhos farai un vers pauc convinen et Pois de chantar m’es pres talens.

Guilhem, qui avait délaissé le latin de l’Église, s’était-il amusé à détourner la musique liturgique en composant des poèmes sur des airs existant déjà dans les tropes et les versus, par défi et pour réjouir ses compagnons ?
Les Maîtres du troubar : Guilhem de Peiteus – Guilhem de Poitiers (1071-1126) – La Tròba, l’invention lyrique occitane des troubadours XIIe-XIIIe s. (Tròba Vox, 2020)
Gérard Zuchetto
Sources :
Manuscrit (s) à notation musicale : STMart. fol. 51v ; F : Chigi fol 81
Principale (s) édition (s) : Jeanroy Alfred, Les Chansons de Guillaume IX duc d’Aquitaine, Paris, 1913 et 1927 (Ed. Champion) ; Durrson Werner, Wilhelm von Aquitanien. Gesammelte Lieder, Zurich, 1969 ; Pasero Nicolo, Gugliemo IX, poesie, Modena, 1973 (Società tipografica editrice Modenese) ; Bezzola Reto Guillaume IX et les origines de l’amour courtois, Paris, 1940 (Romania vol. LXVI) ; Payen Jean- Charles, Le Prince d’Aquitaine. Essai sur Guillaume IX et son oeuvre, Paris, 1980 (Champion)
Miniature : BNF Ms. fr.12473, fol.128
Au sujet de Gérard Zuchetto, voir également Mos cors s’alegr’ e s’esjau de Peire Vidal et Quan Veil la lauzeta mover de Bernart de Ventadorn.
En vous souhaitant une belle journée.
Fred
Pour moyenagepassion.com
A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.
