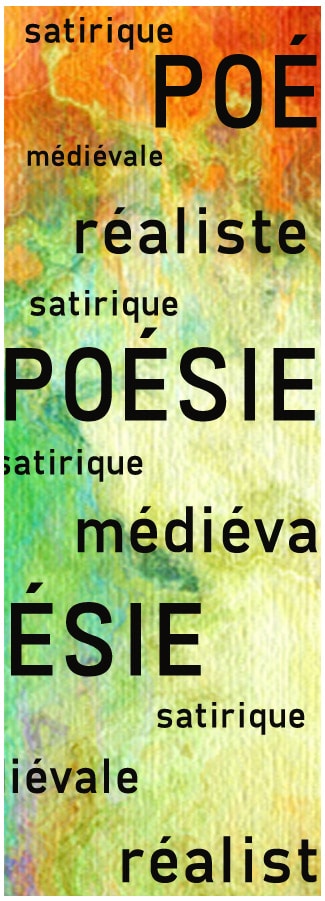
Période : moyen-âge central, XIIe, XIIIe siècle
Auteur : Guiot de Provins (ou Provens) (1150 – 12..)
Manuscrit ancien : MS français 25405 bnf
Ouvrage : Les Oeuvres de Guiot de Provins, poète lyrique et satirique, John Orr (1915)
Bonjour à tous,

Aventures et voyages de cour en cour
Il serait né autour de 1150. En Champagne et à Provins comme son nom semble l’indiquer ? Sans doute. Aucun document ne permet véritablement de l’attester, mais un certain nombre d’auteurs semble s’accorder sur ce point, en recoupant la liste des seigneurs qu’il dit avoir servi et qui sont champenois. Dans la courte « biographie » qu’il en faisait dans son ouvrage « Les Oeuvres de Guiot de Provins, poète lyrique et satirique », John Orr n’était, de son côté, pas si affirmatif, en suivant le poète qui paraissait plutôt indiquer, dans certains des vers, être né en Île de France et donc être plus « français » que « champenois ».

Dans cette première partie de sa vie, le poète fut, de ses propres dires toujours, extrêmement actif dans ses périples, au point même de pouvoir citer près d’une centaine de seigneurs qu’il dit avoir vu lors de ses pérégrinations et qui l’auraient honoré pour ses dons de trouvère, en deniers trébuchants.
« Je ne vous ai baron nommé
Qui ne m’ait veü et donné;
Por ce sont en mon livre escrit »
Il déplorera même, en parlant de certains de ces hommes de pouvoir défunts, la perte « d’amis », laissant entendre une certaine proximité avec eux, même s’il demeure difficile d’en évaluer le degré. Il reste que la liste qu’il en fournit entre ses « amis » et les autres demeure impressionnante.
De la vie de trouvère à l’ordre monastique
Durant la deuxième partie de son existence, le trouvère embrassera la carrière monastique. Contemporain de la troisième croisade, qui, à la fin du XIIe siècle, avait appauvri les seigneurs, leurs richesses et quelquefois même décimés certains d’entre eux, est-il revenu de ses aventures en terres lointaines pour retrouver une France seigneuriale asséchée par l’effort qu’avaient supposé les expéditions guerrières en terre sainte, affaiblie encore par les manœuvres royales de Philippe-Auguste rentré tôt des croisades pour ébranler la féodalité ? Certains de ses bienfaiteurs avaient-il été également emportés dans les flots meurtriers des batailles croisées, à l’image de Frédéric Barberousse ?
Peut-être, l’histoire ne le dit pas très clairement, mais c’est, en tout cas, l’hypothèse que forme John Orr, l’un de ses biographes, éminent professeur de l’Université du Manchester au début du XXe siècle. Pour lui, Guiot de Provins se serait trouvé, à son retour, face à une période charnière et à la naissance d’une poésie des trouvères qui glissait vers le public bourgeois et citadin, au détriment des cours des seigneurs exsangues. Certains poètes surent en tirer leur partie 
« …Tout autre, nous l’avons vu, avait été l’existence de notre poète, qui lui n’eut aucune attache avec les villes, et qui dut se trouver, de retour dans cette France nouvelle, vieilli et singulièrement égaré. Il ne se consola point de l’appauvrissement, du dépérissement des cours seigneuriales. Il ne comprit rien ni à la cause ni à la portée de changements qui ne lui apportaient que d’amers déboires. C’est alors qu’il s’en prend aux seigneurs eux-mêmes, et, les traitant d’avares et de dégénérés, devient, de poète courtois et courtisan, poète satirique »
Les Oeuvres de Guiot de Provins, John Orr
De fait, sans le sou et ne trouvant plus les moyens de subsister de son art auprès de cours qui festoyaient largement moins, sinon plus ( il s’en plaindra explicitement dans ses rimes) Guiot de Provins se fera moine, chez les cisterciens de Clairvaux d’abord, mais il n’y restera pas. Les causes de son départ ne sont pas très précises, mais il fera, plus tard, de l’ordre blanc un portrait caustique et sans appel qui fournit quelques éléments d’explication. Se plaignant de la dureté du travail, il fustigera aussi le manque de fraternité et de compassion des moines blancs entre eux, mais de manière plus acerbe encore il nous dira qu’ils sont passés maîtres « dans l’art de trafiquer et de marchander« et qu’ils orientent tous leurs efforts « à agrandir leurs possessions, et à voler les terres des pauvres gens, les obligeant ainsi à mendier leur pain. »
Après seulement quatre mois, le nouvellement moine et ancien trouvère quittera donc l’abbaye de Clairvaux et se fera « moine noir », autrement dit bénédictin, pour finalement se retrouver à Cluny où il passera vraisemblablement tout le reste de son existence. Après une vie d’errance et un premier « métier » tout entier tourné vers le beau verbe, l’éloquence et le faste (même relatif pour un trouvère) des cours, la vie monastique, ses contraintes, ses privations autant que 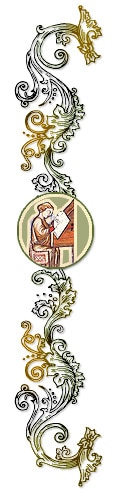
Pour tout dire, à lire certaines de ses lignes et mesurer son inconfort dans cette vie d’ascèse, on en vient même à se demander comment l’homme a fait pour tenir aussi longtemps chez les bénédictins en étant presque si viscéralement opposé, ou du moins si retors à certains aspects de la règle de Saint-Benoit, qui était aux sources même de la vie communautaire à Cluny. Fallait-il qu’il soit laissé à ce point sans choix ? Peut-être le temps passant et l’âge expliquent encore qu’il y soit resté.
L’oeuvre de Guiot de Provins
Que nous reste-t-il de son legs et de ses oeuvres? On les retrouve principalement dans deux manuscrits anciens : le MS français 25405 de la BnF et le Manuscrit 389 de la bibliothèque de Berne.
Lyrisme et amour courtois
Quelques chansons et poésies lyriques, cinq pour être précis, lui ont été attribuées. Elles se situent dans le registre de l’amour courtois. C’est assez conventionnel et sans grande surprise pour un trouvère de l’époque,
La Bible Guiot, satire de son temps :
du monde « civil » aux ordres monastiques

L’ouvrage ouvre sur une satire du monde « laïque » ou plutôt civil et se poursuit sur une satire du clergé, des prélats aux évêques, jusqu’aux ordres monastiques. Les deux parties ne sont liées que par le style et pourraient même avoir été écrites à deux époques différentes mais il demeure que cette satire de l’église et des ordres monastiques (de l’intérieur de surcroît) compte certainement parmi les premiers écrits de ce type en vieux français ou, si l’on préfère, en langue vulgaire.
En langue latine, il y a eu d’autres auteurs avant Guiot de Provins pour le faire et pour critiquer le clergé et ses prélats de ce moyen-âge central, si vite noyés dans les affres de l’opulence, la convoitise, et encore l’apparat et/ou la vie curiale et mondaine. Du XIIe au XIIIe siècle, ce personnel ecclésiastique qui « s’embourgeoise » ou s’empâte n’en finira pas d’ailleurs d’être montré du doigt par les poètes du temps, à travers les fabliaux entre autres textes. Et si on en trouve de nombreux signes dans la littérature satirique, on se souvient 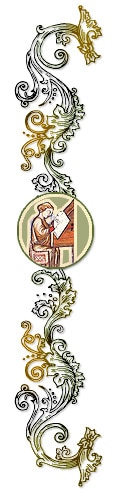
L’empâtement du clergé et son enrichissement n’expliquent peut-être pas tout, et sans doute y avait-il encore là le contrecoup d’une réforme grégorienne qui, par son centralisme, avait confisqué une certaine forme de relation directe de l’homme à Dieu. Les intermédiaires, leur probité autant que leur légitimité se retrouvaient d’autant plus en question.
Le succès des ordres mendiants suivrait, intégré cette fois par l’Eglise, et même si ce succès allait être aussi dû à une plus large ouverture de la carrière monastique aux classes bourgeoises et urbaines, ce même constat critique d’un éloignement des sources chrétiennes se trouvait déjà sans doute en germe à l’intérieur même des ordres monastiques et chez certains de ses moines. En son temps, Guiot de Provins n’était certainement pas le seul d’entre eux à regarder autour de lui avec une certain recul satirique, moral et critique. Du reste, sa « Bible » satirique semble avoir été relativement populaire et lue durant le XIIIe siècle. Les références qu’en donnent d’autres auteurs qui l’ont succédé l’attestent, autant que le nombre relatif de manuscrits dont beaucoup se sont perdus ou égarés depuis.
A titre anecdotique, mentionnons encore que l’ouvrage est un des tout premiers à mentionner la boussole et son principe.
Le reste de l’oeuvre

Enfin, il existe un débat du coté des spécialistes de littérature médiévale allemande qui n’est toujours pas tranché et qui tendrait à assimiler Guiot de Provins à un autre poète de langue française connu sous le nom de Kyot, Kyot Frage ou encore « le provençal« , auteur d’un Perceval postérieur à celui de Chrétien de Troyes et qui aurait inspiré à son tour, le Parzival du poète Wolfram Von Eschenbach (1170-1220). Ce dernier lança d’ailleurs le débat en clamant ouvertement cette référence, mais l’ouvrage auquel il faisait allusion s’étant perdu depuis, sauf à en trouver une autre copie quelque part, la question est demeurée ouverte.
Un moine rieur et bon vivant, franc parleur, fin observateur et critique
« …ennemi du charlatanisme de toute espèce, aimant la bonne chère et riant gros; jouissant de son franc-parler mais sans méchanceté ; juste, bon et sensé. »
Les Oeuvres de Guiot de Provins, John Orr
Quoiqu’il en soit, pour en revenir à ce trouvère et moine du moyen-âge central atypique que fut Guiot de Provins, nous aurons dans de prochains articles l’occasion de savourer quelques extraits de sa poésie, empruntés, notamment, à sa bible satirique. A cette occasion, nous goûterons au passage son style direct autant que la distance et le sens de l’auto-dérision dont il a su aussi faire montre.
En vous souhaitant une belle journée.
Fred
Pour moyenagepassion.com
A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.


 ‘où vient la notion d’Amour Courtois ? En dehors de son « invention » au XIXe siècle par Gaston Paris, que recouvre-t-elle de réalités médiévales et quelles furent les conditions de son émergence ? Voilà autant de questions que France Culture se proposait d’adresser en mars 2016 dans le cadre de son programme la Fabrique de l’Histoire, en invitant à sa table trois éminents universitaires et spécialistes d’histoire et de littérature médiévale : Michel Zink, professeur au Collège de France (Chaire de Littératures de la France médiévale), Didier Lett (professeur d’histoire médiévale à l’université de Paris 7) et Damien Boquet (maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille I).
‘où vient la notion d’Amour Courtois ? En dehors de son « invention » au XIXe siècle par Gaston Paris, que recouvre-t-elle de réalités médiévales et quelles furent les conditions de son émergence ? Voilà autant de questions que France Culture se proposait d’adresser en mars 2016 dans le cadre de son programme la Fabrique de l’Histoire, en invitant à sa table trois éminents universitaires et spécialistes d’histoire et de littérature médiévale : Michel Zink, professeur au Collège de France (Chaire de Littératures de la France médiévale), Didier Lett (professeur d’histoire médiévale à l’université de Paris 7) et Damien Boquet (maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille I).


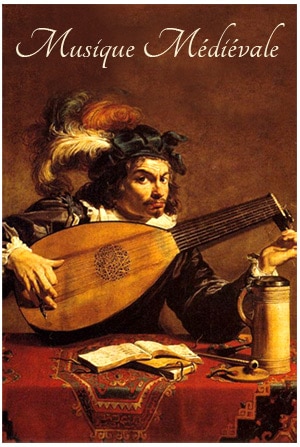 Sujet : musique médiévale, Cantigas de Santa Maria, galaïco-portugais, culte marial, miracles, pèlerinages médiévaux.
Sujet : musique médiévale, Cantigas de Santa Maria, galaïco-portugais, culte marial, miracles, pèlerinages médiévaux. n route pour la grande Espagne médiévale du XIIIe siècle, celle de la cour d’Alphonse le Sage et l’incontournable héritage musical et poétique qu’il nous a laissé avec les célèbres Cantigas de Santa Maria.
n route pour la grande Espagne médiévale du XIIIe siècle, celle de la cour d’Alphonse le Sage et l’incontournable héritage musical et poétique qu’il nous a laissé avec les célèbres Cantigas de Santa Maria.
 Il est donc ici question d’un miracle survenu en Flandres, nous dit le poète. Une femme avait apporté à la vierge et en son église, son petit enfant pour que la Sainte le prenne sous sa garde et le protège du malheur.
Il est donc ici question d’un miracle survenu en Flandres, nous dit le poète. Une femme avait apporté à la vierge et en son église, son petit enfant pour que la Sainte le prenne sous sa garde et le protège du malheur.